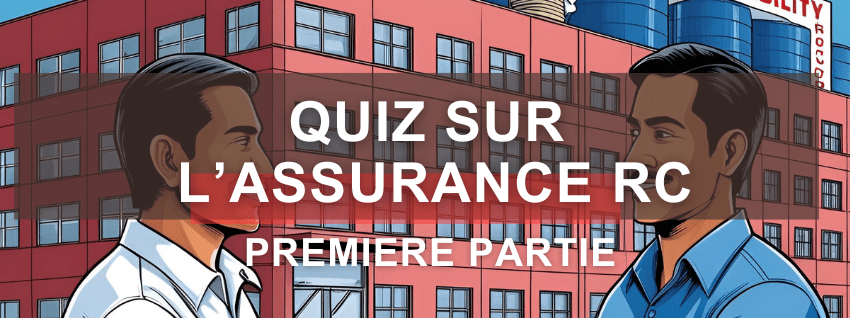5 questions sur le droit de la Responsabilité Civile pour l'Entreprise.
1 - La garde juridique
Réponse : VRAI
La présomption de responsabilité du gardien est le principe même de la responsabilité du fait des choses créée par la jurisprudence sur la base de l’article 1242 du code civil (anciennement 1384). La victime a une position juridique privilégiée (par rapport à la responsabilité du fait personnel), puisqu’elle n’a pas de faute à prouver, mais elle doit, bien entendu prouver et quantifier son dommage et démontrer que ce dernier a été causé par le fait actif de la chose, c’est à dire établir le lien de causalité.
La chose à l’origine du dommage est pour la jurisprudence n’importe quel objet ; il s’agit donc aussi bien d’une chose dangereuse en soi comme une arme à feu ou une bouteille de gaz, qu’une chose inoffensive tel qu’un port de fleur qui peut devenir dangereux dans certaines circonstances.
La chose peut être actionnée par la main de l’homme (par exemple, un parapluie en main), ou être inerte (le même objet déposé dans un vestibule).
Les véhicules terrestres à moteur constituent depuis la Loi Badinter (05/07/1985) un cas particulier régi par un régime juridique de responsabilité bien spécifique.
Le gardien suivant la définition de la jurisprudence est celui qui a sur la chose un « pouvoir d’usage, de contrôle de direction » ; autrement dit, c’est la personne qui maîtrise la chose, qui est la plus à même d’empêcher la réalisation du dommage. La notion de gardien ne doit donc pas être confondue avec celle de propriétaire.
Il convient cependant de préciser que le gardien présumé responsable du dommage peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute de la victime.
2 - La Faute intentionnelle des préposés
Réponse : VRAI
L’entreprise, en tant que commettant ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant la faute du préposé, même en cas de faute intentionnelle (article L121.2 du Code des assurances).
Mais pour que la responsabilité du commettant soit retenue, encore faut-il que le dommage ait été causé par le préposé dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Après avoir payé, l’assureur peut récupérer les sommes versées à la condition de prouver la faute intentionnelle du préposé.
Certes, le commettant peut (essayer) de s’exonérer de sa responsabilité, mais pour cela, selon la jurisprudence, il lui appartient de prouver l’abus de fonction de son préposé.
Cette preuve est difficile à apporter, car l’abus de fonction exonère le commettant de sa responsabilité et débouche par voie de conséquence sur la responsabilité personnelle du préposé avec les risques inhérents d’insolvabilité.
3 - La Faute inexcusable de l’employeur
Réponse : VRAI
En cas de faute inexcusable à l’origine d’un accident de travail, les conséquences pour l’employeur sont lourdes.
La responsabilité pénale de l’employeur est engagée non seulement par sa propre faute, mais aussi par celle des préposés auxquels il a pu confier, par délégation expresse ou tacite, la direction de l’affaire ou d’un travail.
La faute inexcusable a été juridiquement définie par le Cour de cassation dans un arrêt du 15/07/41 : « faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’élément intentionnel de la faute intentionnelle ». L’application de cette définition juridique est faite par les juges du fond.
A la différence de la faute intentionnelle, la faute inexcusable n’implique pas l’existence d’une volonté de nuire ou de voir le dommage se produire
L’élément volontaire s’entend donc au niveau de l’acte et non au niveau du dommage causé.
La jurisprudence de la cour de cassation (arrêts du 28 février 2002 et du 11 avril 2002) a rendu encore plus facile la recherche de la faute inexcusable en faisant peser sur l’employeur une « obligation de sécurité de résultat ».
Ainsi désormais la faute inexcusable de l’employeur sera retenue s’il :
- avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés
- n’a pas informé suffisamment ses salariés sur les risques encourus
- n’a pas pris de mesures de préventions suite à un accident de même nature déjà survenu ou à la suite de remarques formulées par un organisme chargé de la sécurité sur le chantier.
Et la faute de la victime ne pourra exonérer l’employeur de sa responsabilité que si cette dernière est la cause unique du dommage. Il s’agit de la seule cause étrangère admissible.
En cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’entreprise en tant que civilement responsable (article L 452 du Code de Sécurité Sociale) subit le recours de la Sécurité Sociale en remboursement des prestations versées à l’assuré social ou à ses ayants droit en cas de décès. Le remboursement s’effectue par le biais d’une cotisation exceptionnelle.
L’entreprise subit également le recours de la victime ou de ses ayants droit en indemnisation des dommages non réparés par la Sécurité Sociale (dommages moraux par exemple).
4 - La responsabilité du Producteur
Réponse : FAUX
Si effectivement l’article 1245 du Code Civil stipule que “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”, l’article 1245-5 ne limite pas la définition du producteur au seul fabricant du produit fini.
Cet article définit comme producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel :
- le fabricant d’un produit fini,
- le producteur d’une matière première,
- le fabricant d’une partie composante.
Le même article assimile de plus au producteur :
- le distributeur du produit qui appose sur celui-ci son nom, sa marque ou un autre risque distinctif,
- l’importateur du produit dans la Communauté européenne.
La seule exception citée par l’article 1245-5 concerne les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 du Code Civil, c’est-à-dire les fabricants d’ouvrages, de parties d’ouvrage ou de composants de construction dont la responsabilité civile (responsabilité décennale) est solidaire de celle des constructeurs.
5 - Le risque de Développement
Réponse : FAUX
La preuve par le producteur que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut (ce que les juristes et les assureurs appellent le risque de développement) est bien une cause d’exonération de responsabilité du producteur, citée par l’article 1245-10-4°du Code Civil :
Art. 1245-10. – Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
….
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Cependant, bien que la France, lors de l’intégration de la Directive européenne, ait décidé de maintenir cette clause d’exonération, la malheureuse affaire du sang contaminé et des transfusés a créé un débat à l’issue duquel le législateur a forgé une solution qui devrait rallier tous les suffrages :
Le risque de développement reste toujours une cause spéciale d’exonération du producteur, mais l’article 1245-11 prévoit une grande exception. C’est celle-ci qui constitue l’originalité du dispositif juridique français :
Art. 1245-11. – Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
Ce Quiz vous a été proposé par notre équipe de rédaction pour mettre en lumière certains aspects du droit de la Responsabilité Civile.